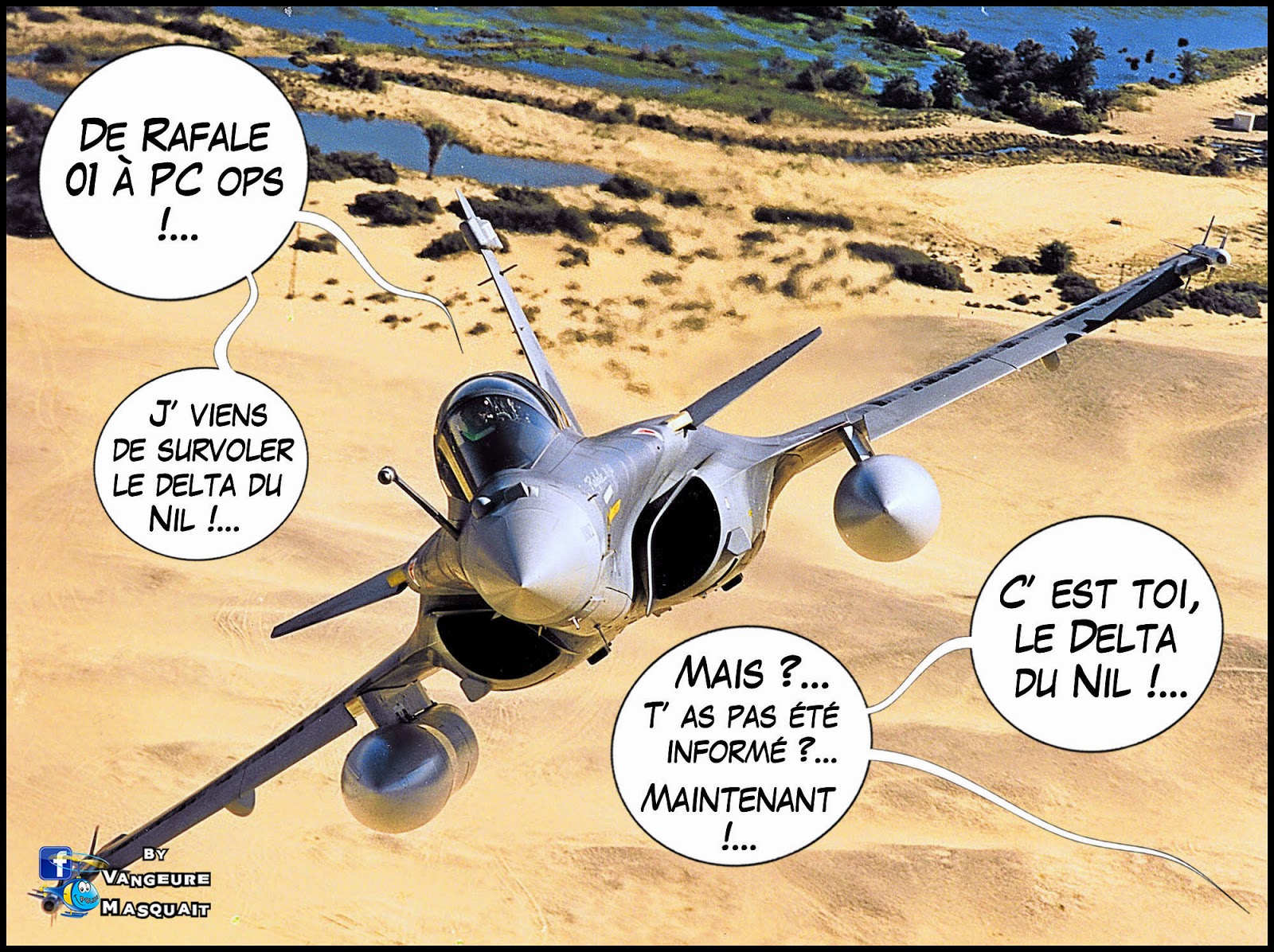Rafale : la révolution dans l’évolution

Ces dernières semaines, il semble que l’avion de combat français soit de nouveau entré dans le cœur des médias français, après des années de bashing incessant. Nombreux sont les quotidiens et journaux de renoms à vanter les mérites de notre chasseur national, alors que la signature d’un contrat n’a certainement jamais été aussi proche.
S’il est vrai que le Rafale possède des atouts qui font de lui un avion capable et accompli, et qu’il s’affiche au-dessus du lot dans certains domaines, il en est un qui n’est jamais abordé, mais qui pourtant mérite qu’on s’y attarde : son évolutivité.
Le Rafale a été conçu comme un avion dont le système d’arme, doté d’une architecture ouverte, est améliorable à l’infini –ou presque. Et là réside sa véritable force que seul le temps sera capable de dévoiler aux nombreux observateurs et détracteurs de ce programme, s’ils ne se limitent pas aux apparences d’un avion qui a volé pour la première fois il y a de cela plus de 20 ans.
Retour en arrière historique.
L’aviation de combat est née pendant la Première Guerre mondiale. À cette époque, et en partant de pratiquement zéro, chaque évolution technique avait pour conséquence une augmentation majeure des performances. C’est ainsi que les avions imaginés quelques mois plus tôt pouvaient devenir obsolètes en un instant, face à un ennemi mettant en ligne un avion nettement supérieur. Au début du vingtième siècle, la période de temps comprise entre l’idée d’un plan d’avion, la réalisation d’un prototype, puis de la production à plusieurs milliers d’exemplaires, et son retrait du service, pouvait s’écouler assez rapidement… De l’ordre de 3 à 4 ans.
Au fur et à mesure de l’avancée des techniques de l’aéronautique puis de l’arrivée des premiers systèmes d’arme, la durée (et donc le coût) de conception va s’allonger exponentiellement, ainsi que la durée de vie de ces appareils. Nous sommes progressivement arrivées jusqu'à une durée de conception d’un système d’arme complet entre 10 et 15 ans, voire beaucoup plus pour les programmes les plus complexes, comme le F-35 qui devrait dépasser les 20 ans. La durée de vie d’un avion dans une armée de l’air a également été allongée. Il n’est pas rare qu’un avion soit prévu pour durer 30 ans, et dans le cas des appareils de nouvelle génération, des chiffres comme 50 ans ne surprennent pas.
Évolutivité des avions de combat moderne
Un des meilleurs exemples que nous offre l’histoire en termes d’évolution d’un avion de combat est certainement le F-16. Du petit avion de combat de jour qu’il était à la fin des années 70, il est progressivement passé au statut d’avion à tout faire, la bête de somme de bien des armées occidentales, avec, grâce à ses derniers standards (Block60/61 émirati notamment) des capacités loin d’être égalées par nombre d’autres avions, même plus récents.
Mais si la cellule reste la même, à l’intérieur de l’avion, tout ou presque a changé. Tous les équipements électroniques composant le système d’arme (Radar, calculateurs, brouilleurs, récepteur d’alerte Radar, IFF, etc.) ont été remplacés. Si le constructeur de l’avion a fait l’économie de la conception d’une nouvelle cellule, motorisation, commandes de vol et tous les essais en soufflerie et en vol que cela nécessite, nous avons bien à faire à chaque fois à un système d’arme nouveau. Si l’avion a bel et bien évolué, il serait plus judicieux de parler de modernisation plutôt que d’évolution.
Tellement nouveau que 40 ans après, des avions neufs sortent toujours de sa chaine de fabrication. En 1975, qui aurait pu imaginer cela ? Et même encore aujourd’hui, cela reste un exploit. Un fait qui n’est pas unique et entre désormais dans l’histoire. La durée de vie d’un avion de combat dans son ensemble a augmenté exponentiellement. Car ce n’est plus les performances permises par le couple cellule/motorisation qui est devenu un facteur clé des performances de l’avion au combat, mais bel et bien son système d’arme.
Dassault Aviation : Technique des petits pas
Partant de ce constat, il serait tentant d’imaginer que les concepteurs du Rafale ont porté la philosophie de Marcel Dassault, la technique « des petits pas » sur la conception du système d’arme devant équiper l’avion.
La technique des « petits pas » est très simple à comprendre. Le fondateur de l’entreprise voulait prendre le moins de risque possible lors de la conception d’un avion. Ainsi, lorsqu’un nouvel avion était conçu, on utilisait toujours une motorisation existante. Si des progrès avaient été réalisés au niveau de l’aérodynamique, on ne changerait que les ailes tout en gardant la même cellule. Et c’est là toute l’histoire de la série des mystères jusqu’aux Mirage. Même la conception du démonstrateur technologique du Rafale n’est pas partie de zéro, puisqu’elle est en grande partie basé sur les acquis du regretté programme Super Mirage 4000.
Apporter cette philosophie sur un système d’arme n’est pas si simple. Surtout qu’avec l’avènement de l’informatique, tous les systèmes s’imbriquent entre eux. Le moindre changement pouvant avoir des répercussions sur l’ensemble des systèmes, les processus de tests et de validation sont complexes, longs et extrêmement rigoureux.
L’informatique évoluant sans cesse, tant en terme d’architecture matérielle que de langages informatiques, permettre de rendre réalisable l’évolution de tout un système pour les 30 ou 40 années à venir est une gageure.
Les concepteurs des systèmes du Rafale vont donc se reposer sur deux concepts bien implantés dans le domaine de l’informatique, mais rarement exploités dans l’aviation, et certainement jamais à cette échelle : la modularité, et la virtualisation.
Une architecture matérielle modulaire
Le principe de base de la modularité, sa définition même, est de pouvoir déplacer ou d’ajouter des éléments en fonction des besoins. On souhaite donc concevoir un système qui permette d’évoluer dans le temps, en ajoutant des « modules » de puissance supplémentaires lorsque cela s’avèrera nécessaire. Le Rafale sera doté d’un calculateur central dénommé MDPU (Modular Data Processing Unit), ou EMTI en français (Équipement Modulaire de
Traitement de l’Information). Chaque MDPU est composé matériellement d’un fond de panier comprenant 18 slots pouvant accueillir autant de modules.
 Dans le détail :
Dans le détail :
Chaque module étant composé d’une carte mère, d’un calculateur (processeur), et de mémoire vive.
Lors du passage à la quatrième tranche de production, les nouveaux Rafale furent livrés avec des modules plus puissant permettant de supporter le surcroit de charge de travail du système apporté par les différentes mises à jour matérielles, et faire face également aux plus grandes données générées dans le système de fusion de données par un Radar AESA capable de voir plus loin, et faire bien plus de choses en même temps.
En 2003, et pour la production du Rafale au standard F2, chaque module EMTI du Rafale était composé d’un processeur PowerPC 740 cadencé à 200Mhz, et accompagné de 64Mo de mémoire vive. En 2006, les modules embarquent désormais un Power PC 750 cadencé à 733Mhz, avec 256 Mo de mémoire.
En ce qui concerne le standard de production actuel, tout au plus savons-nous que les processeurs, toujours basés sur l’architecture Power, ont dépassé le Giga hertz et sont devenus multicoeur.
Les capacités de calcul dépendant de l’architecture matérielle embarquée dans le Rafale sont donc évolutives, et pratiquement sans limites. Si ce n’est le goulet que pourrait devenir la largeur du Bus du MDPU, problème qui n’est pas non plus sans solutions.
Et ce n'est pas fini. Car non seulement les modules de l'EMTI sont remplaçable par de plus puissants, mais Dassault Aviation a prévu large, car un second emplacement est disponible pour ajouter un second Rack EMTI...
Virtualisation des systèmes.
En revenant à l’exemple de la modernisation du F-16, chaque nouveau standard comprenait l’arrivée de nouveaux matériels, et de nouveaux logiciels devaient systématiquement être créés pour pouvoir les utiliser.
Pour simplifier à l’extrême, chaque logiciel est créé et dépend du matériel sur lequel il a été créé pour fonctionner. Comment s’assurer alors que le logiciel du Rafale puisse continuer à évoluer dans les décennies à venir, sans avoir besoin de tout réécrire si jamais le matériel change ? Réponse simple : la virtualisation !
La virtualisation permet une abstraction matérielle. Le logiciel fonctionne dans un environnement qui restera identique toute sa vie durant, et seule la partie logicielle (un hyperviseur) servant à faire le lien entre le matériel et cet environnement sera adaptée.
Lors de l’installation des premiers modules EMTI basés sur une nouvelle génération de processeur en 2006, les ingénieurs ont démarré le système, et… tout a fonctionné du premier coup ! Si des tests poussés sont effectués afin de s’assurer de la non-régression des systèmes de l’avion, aucune réécriture de code des logiciels dont dépend le système d’arme du Rafale n’a été nécessaire.
Rafale Update
Le développement des logiciels n’est jamais arrêté concernant un avion de combat. Avec l’ajout permanent de nouveaux armements, équipement, ou pour répondre à l’apparition de nouvelles menaces, le système de combat évolue sans fin. Les améliorations logicielles sont livrées sous la forme de standard. Il y a les standards principaux F1/F2/F3, chacun subdivisé en sous-standards. Actuellement, le standard en service est le F3’ (prime).
La mise à jour d’un Rafale est réalisée en quelques heures seulement via le branchement d’un ordinateur sur l’avion. S’ensuit une vérification des systèmes et l’avion est de nouveau opérationnel !
Lorsque le standard F3R devra être opérationnel en 2018, l’ensemble des avions de l’Armée de l’Air et de la Marine Nationale seront alors mis au dernier standard de la même façon, et tous seront capables de jouer avec la nouvelle nacelle de désignation laser de Thales, ou de tirer les nouveaux missiles très longue portée Meteor.
Du matériel « Plug & Play »
À la façon d’un ordinateur, un Rafale reconnait automatiquement le matériel qui lui est associé. Cela fait désormais partie du quotidien dans l’informatique. Vous ne vous posez pas la question, lorsque vous branchez un clé USB sur votre ordinateur, s’il faut l’installer ou pas… Et pourtant, il n’y a pas si longtemps que cela, l’ajout de n’importe quel matériel ou périphérique nécessitait une certaine dose de patience pour « apprendre » à l’ordinateur à utiliser le nouveau périphérique.
Le matériel du Rafale a également évolué. Comme nous l’avons vu plus haut, les modules de l’EMTI livrés récemment sont plus puissants que ceux installés dans les avions les plus anciens. Ainsi, il est possible d’interchanger des modules entre les avions plus récents et d’autres plus anciens afin que la puissance de calcul moyenne soit équivalente dans tous les avions en parc. De cette façon, l’armée de l’air met à jour tous ces avions de manière plus ou moins homogène sans avoir besoin de racheter de nouveaux modules. Merci le Plug & Play ; mais cela va beaucoup plus loin que ça.
 Le C137 fut le premier Rafale à sortir de la chaîne d'assemblage de Mérignac avec le tout nouveau radar à antenne active RBE2, en octobre 2012. Mais il n'en profitera pas longtemps car le RBE2 AESA sera démonté puis remonté dans un appareil biplace dans les heures qui ont suivi sa livraison, afin de mener des essais en vol avec un membre d'équipage supplémentaire. Merci le Plug&Play !
Le C137 fut le premier Rafale à sortir de la chaîne d'assemblage de Mérignac avec le tout nouveau radar à antenne active RBE2, en octobre 2012. Mais il n'en profitera pas longtemps car le RBE2 AESA sera démonté puis remonté dans un appareil biplace dans les heures qui ont suivi sa livraison, afin de mener des essais en vol avec un membre d'équipage supplémentaire. Merci le Plug&Play !
Les avions de la quatrième tranche de production sont livrés depuis la fin de l’année 2013. Ils embarquent de nouveaux « périphériques » augmentant très sensiblement les capacités de combat de l’avion, comme le DDM-NG ou le Radar RBE2 AESA équipé d’une antenne active. Ces équipements sont chers, et l’état des finances actuelles de l’armée de l’air ne permet certainement pas d’en acheter pour mettre tous les Rafale à jour. Mais pour maximiser le niveau opérationnel du parc, et lorsqu’un avion de la quatrième tranche est indisponible pour raison de maintenance par exemple, il est tout à fait possible de démonter le nouveau Radar, puis de le monter sur un avion des premiers avions livré en 2005. Étant donné que le logiciel de celui-ci est à jour, il n’aura aucun mal à reconnaitre et à exploiter le plein potentiel de son nouveau périphérique. Durée de l’opération, moins de trois heures !
Synthèse et conclusion :
Avec l’EMTI, la virtualisation et sa gestion des périphériques, le Rafale a été conçu comme une plateforme à très fort potentiel d’évolution. Bien que tous les avions puissent être modernisés profondément pour acquérir des capacités modernes, aucun pour le moment ne peut se targuer d’offrir un si haut niveau d’intégration, lui permettant d’évoluer aussi facilement, et donc à moindre coût. Pour s’en apercevoir, il suffit de regarder la concurrence.
Saab a lancé un programme de modernisation important de son Gripen. Hormis la modification de sa structure qui permettra d’emporter un moteur plus puissant et plus de carburant, la majorité des équipements électroniques sont différents. Outre le fait que les efforts de développement sont importants, et en ne parlant pas de modification structurelle, les anciens avions ne bénéficieront pas des améliorations, sauf à repasser par la case « usine ».
Plus proches du Rafale, nous avons l’Eurofighter, qui a été conçu selon une méthodologie plus traditionnelle. Ainsi, les avions des tranches de production 1, 2 et 3 possèdent chacun des standards logiciels et matériels qui leur sont propres (sans parler de la pléthore de sous-standards). La flotte n’est donc pas homogène, et cela conduit à une perte d’efficacité opérationnelle d’une part, une diminution de la durée de vie utile des premiers avions d’autre part, mais est également devenu un casse-tête logistique qui explique en partie le coût élevé du maintien en conditions opérationnel de ces avions. Voir l'article : Tempête sur le Typhoon.
Il y a également le cas du F-35 qui développe deux standards logiciels possédant les mêmes capacités, mais sur du matériel différent. Le Block 2F est en effet l’équivalent pour le F-35B du block 3I du F-35A, mais les deux avions ne disposent pas du même matériel…
Avec un couple cellule/motorisation offrant de bonnes performances, et un système d’arme à même de pouvoir évoluer sans aucune limite, le Rafale offre à ses utilisateurs un système d’arme tellement évolutif que la perspective du remplacement de l’avion est devenue secondaire… Le Rafale est appelé à se succéder à lui-même, pendant de nombreuses années encore.